Blog fermé
Blog fermé. Pour la suite se rendre sur mon autre blog :
jancet.blogg.org
Blog fermé. Pour la suite se rendre sur mon autre blog :
jancet.blogg.org
Ça rime à quoi

Juan Gelman ©
Poète, traducteur, journaliste, militant révolutionnaire, Juan Gelman est né à Buenos Aires en 1930. Touché dans sa chair par la dictature des années 76-82 (son fils et sa belle-fille disparaîtront dans les geôles de militaires) il connaît un long exil en Europe durant lesquels il écrit ses textes les plus impressionnants. Agé aujourd’hui de 81 ans, lauréat des plus grands prix de poésie hispaniques comme le Prix Cervantès, le Nobel espagnol en 2007, il est considéré comme l’un des plus grands poètes latino-américains vivants. Plusieurs de ses livres ont paru en français dont Salaires de l’impie et autres poèmes, traduit par Jean Portante, éditions PHI, Luxembourg, Lettre à ma mère traduit par François-Michel Durazzo, Myriam Solal éditeur, Paris, 2002, L’opération d’amour, traduit par Jacques Ancet, Gallimard, 2006, Lettre ouverte suivi de Sous la pluie étrangère 2011 sont publiés aux éditions Caractères, dans une traduction de Jacques Ancet.
Juan Gelman sera l’invité de la Maison de la Poésie à Paris le dimanche 15 janvier 2012 à 16h pour un entretien et un récital

Jacques Ancet ©
Jacques Ancet, Lyon, 1942. Il est l’auteur d’une quarantaine de livres (poèmes, romans, essais) dont, récemment, L’Identité obscure Lettres Vives, 2009 (Prix Apollinaire, 2009), Le silence des chiens, publie.net, 2009, L’amitié des voix, publie.net, 2009, Puisqu’il est ce silence, Lettres Vives, 2010, La tendresse, publie.net, 2011, Chronique d’un égarement Lettres Vives, 2011, Portrait d’une ombre, Po&psy, 2011... Auteur également d’un soixantaine de traductions dont, entre autres, des versions de Jean de la Croix, de Gómez de la Serna, de Cernuda, Valente ou Gamoneda, il vient de publier deux anthologies, l’une de Jorge Luis Borges, La Proximité de la mer, 99 poèmes, Gallimard/Du monde entier, 2010, l’autre de Francisco de Quevedo Les Furies et les peines, 102 sonnets, Poésie/Gallimard, 2011
Poèmes lus par Juan Gelman, Jacques Ancet, Thibault de Montalembert
Programmation musicale
Bandonéon de Cesar Stroscio issu des albums Ruisaneres de nuevo et Musiques du rio de la plata label Buda Musique en 1988 et 1995
Invité(s) :
Juan Gelman
Jacques Ancet, traducteur de l'espagnol (Maria Zambrano, José Angel Valente), essayiste, romancier, poète
Thème(s) : Littérature| Poésie
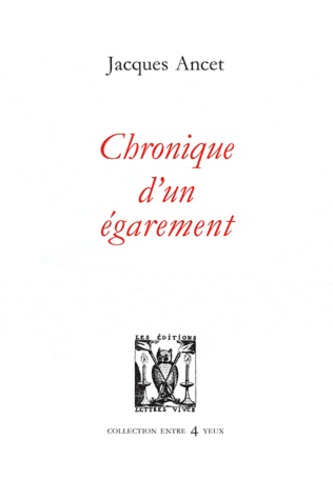
Je suis perdu. Tout va bien. Il fait une journée magnifique. Les champs sont en herbe, le ciel plus près de la terre, mais je suis perdu.
Est-ce l’âge ? Ce sentiment d’être partout à côté. Ou alors ici, mais totalement. Si bien que les choses me submergent.
J’essaie de résister : entretenir la vie, répondre au téléphone, faire bonne figure. Parfois, c’est comme un éclat : j’y suis vraiment, je ris, les autres se rapprochent.
Aujourd’hui est un jour comme un autre.
Ou peut-être non, à cause de l’été précoce. Globalement, pas de raisons de se réjouir (petits malaises, grèves, guerres, massacres), mais le matin ressemble à l’enfance. Aux matins de l’enfance, je veux dire. Avec cette légèreté du ciel plus vif dans les arbres ou près du rouge des géraniums entrevus à une fenêtre d’un dernier étage. La fenêtre était ouverte. J’ai pensé que toute une histoire pourrait s’écrire à partir de cette seule fenêtre ouverte. Ce qui se passerait dedans, dans l’obscur de l’encadrement. Aucun drame. La vie, simplement, avec ses hauts et ses bas. Ce qu’on ne peut jamais dire…
Décidément, je suis perdu. Je vais, je viens. Je voyage, je dors. J’aime la lumière du matin. C’est comme une porte entrebâillée : elle va s’ouvrir, je le sais. Mais elle ne s’ouvre pas. Ou si peu. Alors je regarde par l’embrasure. Je vois une sorte de clair, avec des yeux. Une rue aussi, une silhouette qui s’approche. Elle tient un enfant par la main. Elle passe sans me regarder.
Pourquoi s’obstiner ? Jardin, maison, campagne, ville ressassent leurs couplets. Je les entends, je les écoute même. Je les reprends avec eux. Et soudain c’est comme si tout m’abandonnait. Je balbutie, je me tais. L’amour lui-même m’égare un peu plus.
–– C’est toi ?
–– C’est moi.
Ma main se tend. Comme si elle quittait mon corps. Je la vois toucher la tienne, mais comment la rattraper ? Le jour va trop vite –– et la nuit. Même quand j’y suis, il est trop tard.
L’été vient de face comme un insoutenable regard. Dans le chêne, des morceaux de bleu qui bougent. Ou les feuilles, les yeux, comment savoir puisque tout se tient. On fume. On parle. Ce que je veux dire je ne le dis pas. Autre chose, toujours. Ces menus riens, mouches, pailles ou cris d’enfants. Et l’attente, là, quelque part entre gorge et ventre –– une sorte de vide que rien ne remplit, ni l’ombre, ni la lumière, ni les paroles, ni leur envers. Si je marche, quelqu’un marche avec moi, un peu en avant, il m’oblige à le suivre, à courir parfois. Si je dors, il traverse mon sommeil. Je crois savoir : erreur : je ne sais pas puisqu’il se réveille avant moi, brouille chacune de mes pensées, éclate de rire quand je suis sombre, me ferme la bouche quand je crie. Alors, comment ne pas être perdu même au milieu d’un jour sans histoire : lumière, silence et ciel trop bleu ? L’histoire, on le sait bien, est ailleurs. Pas là où l’on croit, en tout cas. Très loin, tout près, cancer invisible qu’on détecte toujours trop tard. D’un jour sur l’autre un avion ne cesse de passer comme si tout s’était arrêté ; gestes, ombres sur le sol, feuilles agitées par le vent, mouche et, sur l’écran l’interminable vertige d’une image sans futur.
[...]
Quelle chance que d’avoir ignoré jusqu’à maintenant la poésie de Kiki Dimoula (Athènes, 1931), pour connaître l'émotion d'en faire aujourd'hui la découverte éblouie! Grâce à deux livres qui nous présentent trois recueils de la maturité : Le Peu de monde (1971) suivi de Je te salue Jamais (1988), chez Poésie/Gallimard (1) et Mon dernier corps (1981), qui vient d’obtenir le Prix Européen de Littérature 2010, chez Arfuyen (2). Le tout, traduit avec brio par Michel Volkovitch. Ce qui signifie, évidemment — mais est-ce une évidence pour tout le monde ? — qu’on ne lit pas tout à fait Kiki Dimoula, mais sa voix dans la voix de son traducteur et que c’est donc de lui aussi bien que d’elle qu’on parlera ici, puisque les poèmes de ces deux livres sont des poèmes français, même si Mon dernier corps se présente en version bilingue accessible seulement à ceux — et ils sont de moins en moins nombreux de nos jours — qui peuvent déchiffrer l’alphabet hellénique.
Ce que Michel Volkovitch réussit apparemment à faire (puisque je suis de ceux qui ne lisent pas le grec), c’est à nous faire entendre un ton d’une singularité absolue dans la poésie d’aujourd’hui. Kiki Dimoula est un poète élégiaque, mais un poète élégiaque critique — qu’on lise, pour s’en convaincre, le premier poème de Le Peu de monde : « passée ». Cet oxymore signifie-t-il quelque chose ? Une élégie qui ne s’abandonne pas à l’effusion et rit discrètement et même ouvertement d’elle-même, cela signifie-t-il quelque chose ? Une voix vouée à la perte et à la disparition et qui, au lieu de pleurer, s’en amuse tristement, cela signifie-t-il quelque chose ? Oui, car ce refus de s’enchanter en chantant sa peine, donc de s’abandonner au charme du poème et à sa consolation, signifie, du coup, un désespoir redoublé. Dans leur lucidité souriante, les poèmes de Kiki Dimoula sont ravageurs :
Ô toutes choses vaines ne pleurez pas.
Vous êtes seules en ce monde à vivre éternellement.
(JTSJ, 201)
Cette force de langage insinuante qui vous investit et ne vous lâche plus, repose sur un procédé qui semble être sa marque : une matérialisation de ces manifestations foncièrement immatérielles que sont, soit les grandes instances « métaphysiques » — la mort, le temps, la durée, la vie, la divinité, l'être, le néant... —, soit les mouvements mentaux ou affectifs — la raison, le désir, la douleur... — soit ces choses tout aussi impalpables même si elles peuvent être sensibles, que sont, par exemple, les phénomènes atmosphériques (le jour, la soirée, les nuages, la pluie, etc.). Chose qui pourrait sembler somme toute assez banal si cette personnification n'était de signe descendant. Autrement dit, si elle n'entraînait une métamorphose par le bas de toutes ces forces dont nous sommes faits, à travers un usage systématique d'expressions empruntées au registre le plus quotidien de l'existence. Toutes choses qui donnent à cette poésie ce ton inimitable qui est le sien. Que ce soit dans le registre de la personnification insolite (« C'est à toi, Soudain, que je m'adresse // A toi Soudain, nourri de rêve, / beau gosse d'une bravoure folle, / enfant bâtard de causes inconnues... » MDC, 23), dans celui de l'humour triste (« Le calme absolu en moi / met toujours ses pantoufles à tout hasard. / Des désirs logent à l'étage en dessous. » JTSJ, 143), de l'impertinence (« Un Christ affairé comptait / avec une passion d'avare / ses richesses: / clous et épines. » LPM, 35), ou, simplement, de l'image inattendue (« Novembre, à Delphes, est en restauration. » JTSJ, 160).
Ce croisement du noble (les sentiments, la vie, la mort) et du trivial (qui rappellerait de très loin la banalisation des grands mythes grecs chez Yannis Ritsos), s'opère évidemment dans un constant travail de langage. Et c'est là qu'il faut saluer le traducteur dans son effort de recréation des inventions verbales (« terrestritude », réancianniser », l'Oublioir »), des jeux de mots (si j'ai pour non Hélas ou Est lasse / ») des expressions toutes faites perverties (« le corps a enfilé son âme de nuit » JTSJ, 148) et du travail sur les signifiants (« ce poème à moi / le seul poème / qui soit à moi / tout à moi. / Et se noie. » MDC, 39).
Le sarcasme, la pirouette verbale, l'humour, ne sont pas absents de la poésie contemporaine. Mais rares sont les œuvres qui savent les associer à cette tristesse profonde qui est celle de Kiki Dimoula. Ou, plutôt, à cette tristesse de fond. La vie est passée avec « le camion des pleurs », la douleur a tout dévasté — l'être aimé a disparu, au moins dans Je te salue Jamais dont le titre est tout un programme. Ne reste que la poésie qui est pour Kiki Dimoula une manière d'être — de se tenir dans l'être — quand celui-ci fait eau de partout. Une manière de regarder le rien en face. Ne serait-ce que dans sa forme la moins dramatique et la plus quotidienne, celle de la photographie. A laquelle elle sait donner dans ses livres un statut privilégié puisque, présence de l'absence, elle est l'incarnation sur le papier de ce non-être qui ne cesse de la hanter et auquel ne cesse de répondre avec l'énergie du désespoir toute sa poésie :
Ta photo s'est presqu'imposée.
…............................................
Jour après jour, elle me convainc que rien n'a changé,
que tu as toujours été ainsi, être de papier.
…...................................................................
De temps à autre un vague coup de fusil
témoignage en ta faveur la tristesse
qu'elle se rende.
Pour prouver qu'on a vécu le seul vrai témoin
C'est notre absence.
(JTSJ, 197)
1 Kiki Dimoula, Le Peu de monde suivi de Je te salue Jamais, préface de Nikos Dimou, Traduit du grec par Michel Volkovitch, Poésie Gallimard, 2010. Ici respectivement en abréviation LPM et JTSJ.
2 Kiki Dimoula, Mon dernier corps, présenté et traduit du grec par Michel Volkovitch, Arfuyen, 2010. Ici en abréviation MDC.
Milonga de Jacinto Chiclana
(Pour la lecture de la traduction intégrale, on se reportera à mon anthologie La Proximité de la mer, Gallimard 2010, collection "Du Monde entier", p.77.

Programme colloque Jacques Ancet
En présence du poète
Université de Pau et des Pays de l’Adour
Vendredi 22 octobre 2010 salle Chadefaud, UPPA.
9h30 accueil des participants.
Modérateur : Michel Bernier
10h00 Jean-Yves Pouilloux, UPPA, « Veilleur obstiné dans le jour bas ».
10h30 Serge Martin, Université de Caen, « Jacques Ancet : la voix-relation ».
11h00 Questions. Pause.
11h30 Régis Lefort, Université de Provence, « L’appel, l’attente et autres patiences tragiques ».
12h00 Yves Charnet, Université de Toulouse, « Lettre à Jacques Ancet ».
12h30 questions.
Déjeuner à La Vague.
Modérateur : Annick Allaigre.
14h30 Sandrine Bédouret, UPPA, « Voir-entendre au service d’un vivre-écrire ».
15h00 Emmanuel Hiriart, Poésie Première, « Jacques Ancet et le livre pauvre ».
15h30 Blanche Brissaud, Université Paris IV, "Figures de l'innommé dans L'identité obscure de Jacques Ancet".
16h00 Questions. Pause.
16h30 Marie-Claire Chatelard, UPPA, « La Dernière Phrase ».
17h00 Dominique Carlat, Université Lyon 2, « La parole face au deuil ».
17h30 Questions.
18 h Lecture de poèmes, par Jacques Ancet.
Samedi 23 octobre 2010, château de Pau.
Modérateur : Jacques Le Gall.
9h00 Marie-Antoinette Bissay-Laffont, UPPA, « Un morceau de lumière ou le journal d'une traversée ».
9h30 Laurent Mourey, énonciations intérieures du Silence des chiens.
10h00 Questions. Pause.
10h30 Annick Allaigre, Université Paris VIII, « Traduire pour penser, traduire pour créer : la traduction chez Jacques Ancet ».
11h00 Denise Gellini, UPPA, « Autour de plusieurs traductions d'un sonnet de Quevedo ».

Jorge Luis Borges
La Proximité de la mer, anthologie de 99 poèmes, éditée, préfacée et traduite par Jacques Ancet
Gallimard, 2010 — Collection "Du Monde entier".
Composé et traduit avant tout pour le plaisir, ce livre a fini par devenir, à mon corps plus ou moins défendant, une anthologie. Mais une anthologie purement subjective en ce qu’elle n’a pas la prétention de donner un aperçu vraiment représentatif de toute la poésie de Borges. J’y ai un peu boudé, par exemple, les compositions patriotiques ou historiques qui, si elles peuvent intéresser un Argentin ou plus généralement un lecteur de langue espagnole, ont moins d’attrait pour un Français. Par contre, j’ai donné la préférence aux poèmes méditatifs et élégiaques en vers comptés et rimés et, à un moindre degré en vers blancs, parce que ce sont eux qui m’ont semblé devoir être retraduits en priorité et, surtout, parce que ce sont eux qui me touchent le plus. Comme ces hommages rendus aux œuvres fondatrices de l’humanité — la Bible, le I King, l’Iliade et l’Odyssée, la Geste de Beowulf, les Mille et Une Nuits, Don Quichotte… — et aux penseurs et aux écrivains admirés — Héraclite, Cervantès, Shakespeare, Quevedo, Spinoza, Milton, Keats, Heine, Emerson, Whitman, Browning, Verlaine, Stevenson, Joyce … — qui, avec les kabbalistes, les poètes japonais ou les paroliers de tango, dessinent les contours fluctuants d’une curiosité insatiable et d’une mémoire où « je » finit par être beaucoup d’autres. Mais, si j’ai éliminé les pièces en prose, sauf une, qui me semble résumer parfaitement la poétique de Borges, j’ai conservé quelques poèmes en vers libres sans autre justification que le plaisir qu’ils m’ont donné à les traduire.
L’ordre chronologique des recueils a été respecté, malgré quelques textes déplacés dans un souci d’équilibrer l’ensemble et d’éviter une monotonie qui, si elle est sensible dans les derniers recueils de Borges (la cécité, l’âge, la disparition, l’oubli)… [1], le devient plus encore du fait du choix quelque peu systématique d’un certain type de pièces. Quant au nombre, il a été dicté, comme dans l’écriture d’un livre de poèmes, par une nécessité intérieure qui, m’ayant emporté par son urgence, s’est peu à peu relâchée pour finalement se tarir une fois cette quantité atteinte : 99, un multiple de 9, comme l’est la date de naissance de Borges (1899) et le chiffre sur lequel repose l’organisation de plusieurs de mes propres ouvrages. Traduire, écrire : le même mouvement, le même mystère les traverse. Être soi-même en l’autre et l’autre en soi-même.
Tout est donc subjectif ici : le choix des textes, leur nombre, la manière de les organiser et, bien sûr, de les traduire. Encore une fois, je n’ai pas seulement traduit ces poèmes avec mes connaissances, ma culture, mon savoir faire qui sont bien modestes comparés à ceux de mon modèle. Je les ai écrits — et c’est peut-être ce qui donne à ce travail sinon sa valeur (comment pourrais-je en juger ?), du moins son authenticité — avec une passion où, plus que le savoir c’est le non savoir qui m’a guidé, plus l’abandon que la maîtrise. Aurais-je toujours réussi à faire entendre quelque chose ? Comme je crois l’avoir fait dans le second et le plus beau des deux poèmes que Borges consacre à Spinoza où, à travers l’image du philosophe, c’est bien sûr celle du poète qui transparaît et, pourquoi pas, ombre d’une ombre, celle aussi du traducteur, tous trois confondus dans ce même et incessant travail — donner forme à l’informe, visage à l’inconnu — dans ce même amour sans espoir que rien d’autre n’éclaire que sa propre lumière :
BARUCH SPINOZA
Brume d’or, le Couchant pose son feu
Sur la vitre. L’assidu manuscrit
Attend, avec sa charge d’infini.
Dans la pénombre quelqu’un construit Dieu.
Un homme engendre Dieu. Juif à la peau
Citrine, aux yeux tristes. Le temps l’emporte
Comme la feuille que le fleuve porte
Et qui se perd dans le déclin de l’eau.
Qu’importe. Il insiste, sorcier forgeant
Dieu dans sa subtile géométrie ;
Du fond de sa maladie, son néant,
De ses mots il fait Dieu, l’édifie.
Le plus prodigue amour lui fut donné,
L’amour qui n’espère pas être aimé.
[1] Cette monotonie, Borges la reconnaît et même la revendique avec humour : « … je suppose qu’à mon âge on attend de moi certains thèmes, une certaine syntaxe, et peut-être aussi une certaine monotonie ; si je ne me montre pas monotone, on restera insatisfait. Arrivé à un certain âge, un auteur doit peut-être se répéter. » , Nouveaux dialogues avec Osvaldo Ferrari, Presses Pocket, 1990, p. 179.
Lionel Ray
Lettres imaginaires Les Ecrits du Nord, Editions Henry, 2010.
Entre nuit et soleil, Gallimard, 2010.
Comme dans Lettres imaginaires, ce mélange de « vers et proses », (comme dit le sous-titre), dans lequel lettres de l’auteur à son double, poèmes, entretiens et essais se croisent et nous offrent en raccourci un itinéraire de plus de cinquante ans d’écriture, dans Entre nuit et soleil, qui paraît conjointement, Lionel Ray se rassemble. Car, après l’intermède inattendu et éblouissant de L’Invention des bibliothèques, ce nouveau livre est comme un pas fait à la fois en avant et en arrière. Un pas, justement entre « nuit et soleil » — entre la nuit du passé, de la nostalgie, du désespoir même et le soleil du présent toujours recommencé, celui de « l’immobile été » qui est celui du poème.
L’élan de L’Invention des bibliothèques est encore perceptible dans les trois sections, chacune de 17 textes, qui structurent le livre : la première, la troisième, la cinquième. Ces « proses » en gardent l’emportement verbal, mais elles sont trouées, rongées de blancs qui sont comme autant d’accrocs, de stigmates du vide : « la vie est un monument d’absence», annonce d’entrée le poète. Et c’est, pour une part, à édifier ce monument que sont consacrés ici un certain nombre de poèmes, renouant par là avec le lyrisme élégiaque qui, d’Une sorte de ciel, à Matière de nuit[1] caractérise les livres publiés depuis vingt ans,.
Mais, pour une autre part, il y a dans ce livre, dans sa section centrale, notamment (dont les distiques rappellent ceux de « Résidence dans les fragments » d’Une sorte de ciel), quelque chose qui résiste au délitement, à la déréliction. Quelque chose fait de sursauts de lumière, de bouffées de désir, d’éclats d’enfance, qui traverse les chambres désertes, les jardins abandonnés et les illumine d’une clarté sans âge :
demain est
une matière bleue.
La joie infime
d’être
traverse les fleurs
Cette écriture « aux yeux de source », c’est, bien sûr, celle du poème — des « poèmes dans leur scintillante jeunesse ». Cette brusque effervescence, ce passage de vie et ses mots soudain neufs auxquels le nombre et sa rassurante rigueur donnent toute leur intensité :
Ce ne sont rien que des mots parmi les mots
[...]
Le nombre est en eux.
Ils ne disent rien que ce qu’ils disent
et s’ils brillent dans l’ombre quelques fois,
c’est à cause des sources et des fruits
ou du printemps tardif.
Prise alors entre nostalgie et ferveur, ombre et lumière, quelle est cette voix qui, une fois encore, vient nous saisir dans sa force incisive, dans sa douceur violente parfois, parfois son humour, dans sa pénétrante force visionnaire ? Car tout le livre, comme le précédent et ses jeux de miroirs avec l’hétéronyme Laurent Barthélémy, est traversé par la même interrogation qui en est la clausule : « Qui parle ici ? [...] je voyais quoi ? qui donc voyait ? » Interrogation prolongée sur l’identité et ses mirages (« ce pauvre moi de pacotille est déjà tout rouillé »), laquelle se reconnaît — « toi poudre et dispersé » — fuyante, tissée de vide et d’oubli : « si peu de souffle, si peu de ciel cet homme lourd chargé d’oubli c’était vous, c’était moi ». Phrase à laquelle répond en écho cet « étranger à moi-même [...] n’ayant goût ni au jour qui se dérobe ni à la nuit si proche » d’une des Lettres imaginaires de Laurent Barthélémy à Lionel Ray. Lequel ajoute que tout semble se résoudre en une histoire de « dépossession » , de « l’envahissement du désert interne qui s’affirme une fois de plus »
Pourtant, cette dépossession — cette disparition — qui pourrait paraître sans issue et désespérante est, en même temps, la condition d’apparition d’une altérité inconnue logée au cœur même de cette identité évanescente. Une altérité qui, en la dépossédant d’elle-même, l’ouvre à tout ce qui la déborde. Comme à ces voix aimées qui viennent l’habiter et auxquelles, consciemment ou non, elle ne cesse de faire écho : Rimbaud, avec « Génie » : « des cailloux dans les poches (ou des poèmes ») ; Verlaine : « qu’as-tu fait /de tout ce temps » ; Apollinaire : « mon langage ma violette mon infini sans écho » ; « les mots s’en vont avec / les eaux courantes » (Lettres imaginaires) ( ; Reverdy : « On n’oublie pas. / Dans le miroir / un oiseau passe » ; Borges, à qui renvoient plusieurs titres (« Le miroir », « La clef »...) : « Tu n’es rien d’autre / que ce que tu cherches », « Il ne restera de nous pas une ombre » ; Breton « Ces enfants à tête de chat », et d’autres encore...
La voix qui parle ici, et c’est là son historicité, est faite de toutes ces voix et de quelque chose de plus. De cet inconnu qu’elle ne cesse de poursuivre — « quelque chose d’inconnu en toi / te cherche »[2]— et qui est la vie même soudain recommencée dans la parole toujours renaissante du poème. Puisque, comme le dit bien le poète dans « Les mots et l’émotion poétique »[3], le poème n’est pas le produit d’une émotion préalablement vécue : c’est lui qui la produit dans son fin tissage de mots. Il ne recrée pas le monde — comment le pourrait-il ? — il le crée. Ou plutôt — et c’est la même chose puisque ce que nous appelons « monde » est une description apprise —, il crée un monde de langage. Un langage à l’état naissant où, pour un instant sans mesure, quelque chose comme un monde semble (re)commencer. C’est pourquoi le poème est, pour Lionel Ray, ce « souffle qui te remet au monde »
Avec une voix première, une voix d’avant tout
Langage, un alphabet venu de l’avenir.
[1] Tous ces livres sont également parus chez Gallimard : Une sorte de ciel (1990), Comme un château défait (1993), Syllabes de sable (1996), Pages d’ombre (2001), Matière de nuit (2004).
[2] Lettres imaginaires.
[3] Lettres imaginaires.
Poèmes extraits de La Proximité de la mer, anthologie préparée, préfacée et traduite par Jacques Ancet, à paraître chez Gallimard, coll. Du monde entier, en octobre 2010
LA MER
La mer. La jeune mer. La mer d’Ulysse,
Celle de cet autre Ulysse que ceux
D’Islam ont surnommé d’un nom fameux :
Sindibad de la mer. La mer aux grises
Vagues d’Erik le Rouge, haut sur sa proue,
Et de ce chevalier qui a chanté
Á la fois l’élégie et l’épopée
De sa patrie, à Goa et ses boues.
La mer de Trafalgar, que l’Angleterre
A célébrée au long de son histoire,
La dure mer ensanglantée de gloire
Jour après jour, dans l’œuvre de la guerre.
Au matin calme, la mer intarissable,
Et ses sillons dans l’infini du sable.
L’AVÉNEMENT
C’est moi qui fus dans la tribu, à l’aube.
Étendu dans mon coin de la caverne,
Je luttais pour plonger dans les obscures
Eaux du sommeil. Des spectres d’animaux
Blessés par la flèche et sa pointe d’os
Mêlaient l’horreur aux ténèbres. Une chose,
L’exécution, peut-être, d’un serment,
Un rival trouvé mort dans la montagne,
L’amour, peut-être, une pierre magique,
M’avait été donnée. Je l’ai perdue.
Dévastée par les siècles, la mémoire
Garde, seuls, cette nuit et son matin.
J’étais désir et peur. Soudainement
J’entendis le bruit sourd, interminable,
D’un troupeau, qui passait à travers l’aube.
Mon arc de chêne, mes flèches aigues,
Je les laissai pour courir à la brèche
Ouverte tout au fond de la caverne.
Et je les vis alors. Braise rougeâtre,
Cornes cruelles, échines montueuses,
Laine obscure comme les yeux mauvais
Qui me guettaient. Ils étaient des milliers.
Ce sont les bisons ai-je dit. Le mot
N’avait pas jusque là franchi mes lèvres,
Mais je sentis que tel était leur nom.
C’était comme de n’avoir jamais vu,
Comme d’avoir été aveugle et mort
Avant de voir les bisons de l’aurore.
Je ne voulus pas que d’autres profanent
Ce pesant fleuve de bestialité
Divine, et d’ignorance et d’orgueil,
Indifférent comme sont les étoiles.
Ils piétinèrent un chien sur le chemin ;
Ils auraient fait de même avec un homme.
Puis j’ai dû les peindre dans la caverne
En ocre et vermillon. Ils furent alors
Les Dieux du sacrifice et des prières
Je n’ai pas dit le nom d’Altamira.
Nombreuses furent mes formes et mes morts.
Á UN CHAT
Ils ne sont pas plus silencieux les miroirs
Ni plus furtive l’aube aventurière ;
Tu es, sous la lune, cette panthère
Qu’il nous est donné, de loin, d’entrevoir.
Par œuvre d’un insondable décret
Divin, nous te poursuivons vainement ;
Plus lointain que le Gange et le couchant,
Á toi la solitude, le secret.
Ton dos daigne accepter la nonchalante
Caresse de ma main. Tu as admis,
Dans ton éternité, qui n’est qu’oubli,
L’amour offert par une main tremblante.
Tu es là, dans un autre temps. Le maître,
Comme un rêve, d’un étroit périmètre.
MOI
Le crâne, un cœur avec sa vie secrète,
Les chemins de mon sang dissimulés,
Et les tunnels du rêve, ce Protée,
Les viscères, la nuque, le squelette.
Je suis ces choses. Et, je ne peux y croire,
Je suis aussi un épée, sa mémoire,
Celle d’un soleil seul et déclinant
Qui se disperse en or, ombre, néant.
Je suis celui qui voit les proues, du port ;
Je suis ce peu de livres, de gravures
Fatigués par le temps et son usure.
Je suis celui qui jalouse les morts.
Et, plus étrange, l’homme qui assemble
Des mots chez lui, dans un coin de sa chambre.
COSMOGONIE
Ni ténèbres ni chaos. Les ténèbres
veulent des yeux qui voient, comme le bruit
Et le silence réclament l’ouïe,
Et le miroir la forme qu’il intègre.
Pas plus l’espace que le temps. Ni même
Une divinité qui prémédite
Le silence existant avant l’ancienne
Nuit du temps, la première, sans limites.
Le grand fleuve d’Héraclite l’Obscur,
Fatal, n’a toujours pas creusé son lit
Où du passé il court vers le futur,
Et de l’oubli court aussi vers l’oubli.
Ce qui souffre. Ce qui crie, implorant.
Puis, l’histoire universelle. Á présent.
BROWNING DÉCIDE D’ÊTRE POETE
Au fil de ces rouges labyrinthes de Londres
je découvre que j’ai choisi
le plus curieux des métiers humains,
sauf que tous, à leur manière, le sont.
Comme les alchimistes
qui ont cherché la pierre philosophale
dans le mercure fugitif,
j’amènerai les mots de tous les jours
— cartes biseautées du joueur, monnaie du peuple –
à rendre la magie qui fut la leur
quand Thor était le dieu et le fracas,
le tonnerre et la prière.
Dans le dialecte d’aujourd’hui
je dirai à mon tour les choses éternelles ;
j’essaierai de ne pas être indigne
du grand écho de Byron.
Cette poussière que je suis sera invulnérable.
Si une femme partage mon amour
mon vers frôlera la dixième sphère des cieux concentriques ;
si une femme dédaigne mon amour
je ferai de ma tristesse une musique,
un vaste fleuve toujours sonore dans le temps.
Je vivrai de m’oublier.
Je serai le visage que j’entrevois et que j’oublie,
je serai Judas qui accepte
sa divine mission de traître,
je serai Caliban dans le bourbier,
je serai un soldat mercenaire qui meurt
sans crainte et sans foi,
je serai Polycrate qui voit dans l’épouvante
l’anneau restitué par le destin,
je serai l’ami qui me hait.
Le Persan me donnera le rossignol et Rome l’épée.
Masques, agonies, résurrections,
détisseront et tisseront mon sort
et un jour je serai Robert Browning.
JE SUIS
Je suis celui qui se sait non moins vain
Que l’observateur vain qui, au miroir,
Silencieux cristal, s’applique à voir
Le reflet ou le corps de son prochain.
Je sais, muets amis, je sais trop bien
Qu’il n’est d’autre vengeance que l’oubli,
D’autre pardon. Un dieu un jour offrit
Celle clef rare à notre haine d’humains.
Hors d’illustres erreurs, je suis celui
Qui n’a pu déchiffrer le labyrinthe,
L’unité innombrable, ardue, distincte,
Du temps, qui est à moi, à tous. Je suis
Personne, pas même un glaive sanglant.
Je suis l’écho, l’oubli et le néant.